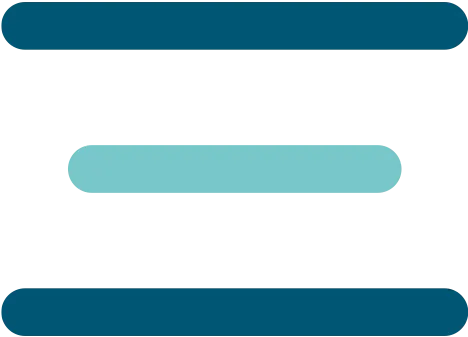Au SSIAD de Saint-Maur, Sherazade Rami fait renaître la cohésion grâce aux équipes autonomes
À travers son parcours au SSIAD de Saint-Maur (ABCD 94), Sherazade Rami a engagé une véritable transformation managériale, fondée sur la conviction que la cohésion d’une équipe passe d’abord par son autonomie. À son arrivée dans le service, elle a trouvé une équipe fragmentée, en tension, parfois même épuisée. Très vite, elle comprend que la solution ne viendra pas d’un contrôle accru, mais au contraire d’une redynamisation de l’autonomie collective.
« J’ai vu des professionnels compétents mais qui ne se sentaient plus acteurs », raconte-t-elle. C’est à partir de cette intuition que naît son projet : reconstruire des équipes autonomes, capables de coopérer, de s’auto-organiser et de retrouver du sens dans leurs missions quotidiennes.
Cette démarche, qu’elle relie à ses travaux de master en organisation et conduite de projet, repose sur une conviction forte : l’autonomie ne se décrète pas, elle se cultive à travers la confiance, la clarté et la co-construction.
* Ce témoignage est issu du webinaire : "équipes autonomes et transformation organisationnelle dans un SSIAD" qui a eu lieu mardi 4 novembre 2025.
Sommaire
- Un parcours d’engagement et de transmission
- Le constat initial : une équipe en souffrance
- Le socle du projet : une lettre de mission
- Le diagnostic humain : l’indice d’alignement comme miroir collectif
- Donner corps à l’autonomie : réorganiser les tournées et les pratiques
- Accompagner la transformation : l’écoute, le sens et la confiance
- Bilan et perspectives : une équipe qui se reconstruit par elle-même
1. Un parcours d’engagement et de transmission
Forte de vingt années d’expérience dans le groupe, Sherazade Rami a connu toutes les facettes du soin : agent hospitalier, aide-soignante, infirmière, coordinatrice, puis cadre de santé. Ce parcours ascendant nourrit sa compréhension des réalités du terrain et des besoins des équipes.
« Je suis aujourd’hui en master d’organisation et de conduite de projet. Cela me permet de relier théorie et pratique », explique-t-elle.
Pour elle, manager, c’est d’abord accompagner la croissance des autres, leur permettre d’agir en autonomie et d’être fiers de leur travail.
2. Le constat initial : une équipe en souffrance
Dès ses premiers jours au SSIAD de Saint-Maur, Sherazade fait un constat frappant : la cohésion d’équipe est brisée.
« Le deuxième jour, j’ai assisté à une réunion où les aides-soignants se déchiraient. Il y avait des cris, de la colère, de la frustration », raconte-t-elle avec émotion.
Ce moment agit comme un électrochoc. Derrière les tensions, elle décèle une perte de sens et une désorganisation qui minent la motivation des soignants. Son objectif devient clair : reconstruire une dynamique d’équipe autour de l’autonomie et de la coopération.
3. Le socle du projet : une lettre de mission
Pour donner un cadre à son action, Sherazade rédige, avec sa direction, une lettre de mission. Ce document devient le fil rouge de son intervention.
Il fixe trois objectifs majeurs :
- Restaurer la confiance et la communication au sein du collectif ;
- Renforcer l’autonomie des équipes, en clarifiant les rôles et responsabilités ;
- Repenser l’organisation des tournées pour plus d’équité et de cohérence.
Cette formalisation n’est pas qu’administrative : elle marque la reconnaissance d’une démarche de conduite de changement assumée, inscrite dans une vision globale du management participatif.
4. Le diagnostic humain : l’Indice d’alignement comme miroir collectif
Avant d’agir, Sherazade choisit de comprendre. Elle met en place le questionnaire d’indice d’alignement humain, un outil d’analyse inspiré du management collaboratif, qui permet d’évaluer le niveau de cohésion, d’écoute et d’adhésion des professionnels au projet collectif.
Chaque membre de l’équipe répond anonymement, exprimant son ressenti sur la communication, le sens du travail, la reconnaissance et la place de chacun dans le groupe.
Les résultats révèlent des déséquilibres : une perte de repères communs, un sentiment d’isolement et une difficulté à coopérer.
Mais au lieu de pointer des failles, Sherazade transforme ces données en levier de dialogue : les résultats sont partagés, discutés collectivement, puis traduits en pistes d’amélioration.
« Ce qui comptait, c’était que les équipes se réapproprient leur réalité et décident ensemble des priorités », souligne-t-elle.
5. Donner corps à l’autonomie : réorganiser les tournées et les pratiques
L’un des leviers majeurs d’action se trouve dans le quotidien opérationnel : les tournées à domicile. Sherazade identifie rapidement que leur organisation est source de tensions, parfois vécue comme injuste ou épuisante.
Elle propose alors une refonte complète des tournées, mais dans une logique participative :
- Chaque soignant contribue à la redéfinition des secteurs ;
- Les temps de trajets, les contraintes personnelles et les compétences spécifiques sont pris en compte ;
- Des binômes de référence sont instaurés pour renforcer la continuité des soins et la solidarité.
Ces ajustements, réalisés collectivement, deviennent un exercice concret d’autonomie : les équipes décident, arbitrent et s’organisent entre elles, sous le regard bienveillant de leur cadre.
« Ce n’était pas une réforme imposée, mais une construction partagée », insiste-t-elle.
6. Accompagner la transformation : l’écoute, le sens et la confiance
La réussite du projet repose sur un management de proximité, fondé sur le dialogue et la confiance. Sherazade instaure des rituels d’équipe :
- Des réunions collaboratives hebdomadaires où chacun peut s’exprimer ;
- Des entretiens individuels pour accompagner les évolutions de posture ;
- Des espaces de réflexion sur le sens du soin et la qualité de vie au travail.
Progressivement, les professionnels s’autonomisent : ils prennent des décisions, s’entraident, résolvent les désaccords sans attendre une validation hiérarchique.
L’autonomie devient un état d’esprit partagé, non une injonction.
7. Bilan et perspectives : une équipe qui se reconstruit par elle-même
Un an après, les effets sont visibles : moins de conflits, plus de fluidité, une communication restaurée. Les aides-soignants témoignent d’un climat plus serein et d’une meilleure reconnaissance de leur travail.
Pour Sherazade, cette expérience prouve que l’autonomie est le moteur du sens collectif.
« L’autonomie n’est pas l’absence de cadre, c’est la capacité de faire ensemble, de décider ensemble, dans le respect du rôle de chacun », résume-t-elle.
Son parcours au SSIAD de Saint-Maur illustre une conviction profonde : on ne soigne bien que dans des équipes qui vont bien. Et des équipes qui vont bien, ce sont celles qui se sentent libres, responsables et reconnues.